Banzeiro Okoto : Amazonie, le centre du monde
« L’effondrement du climat est le résultat d’une façon de comprendre le monde, principalement déterminée par la pensée occidentale, blanche, masculine et binaire ».
Le livre « Banzeiro Okoto : Amazonie, le centre du monde » par Eliane Brum est difficile à résumer. Il raconte avec une précision journalistique remarquable le drame de la déforestation de l’Amazonie dans toutes ses dimensions. Mais au-delà du récit passionnant à découvrir, Eliane Brum offre de multiples pistes de réflexion qui justifient mon coup de cœur. En guise de résumé, je décris quelques-unes de ces pistes de réflexion.
Le fil rouge de « Banzeiro Okoto» est une critique profonde de la pensée occidentale dominante – blanche, masculine, dualiste – qui a imposé au monde une logique extractiviste menant – entre autres- à l’effondrement climatique. Eliane Brum explore, à travers la situation de l’Amazonie, les racines des crises écologique, sociale et/ou politique. Les ressorts aboutissant à la prédation de la nature sont les même que ceux aboutissant à la prédation des territoires (guerres), des populations (exploitations) et finalement des corps (Violences sexuelles et sexistes), notamment féminins. Le patriarcat machiste (post)colonial allié à une vision exclusivement capitaliste a façonné ce rapport à la nature et aux corps.
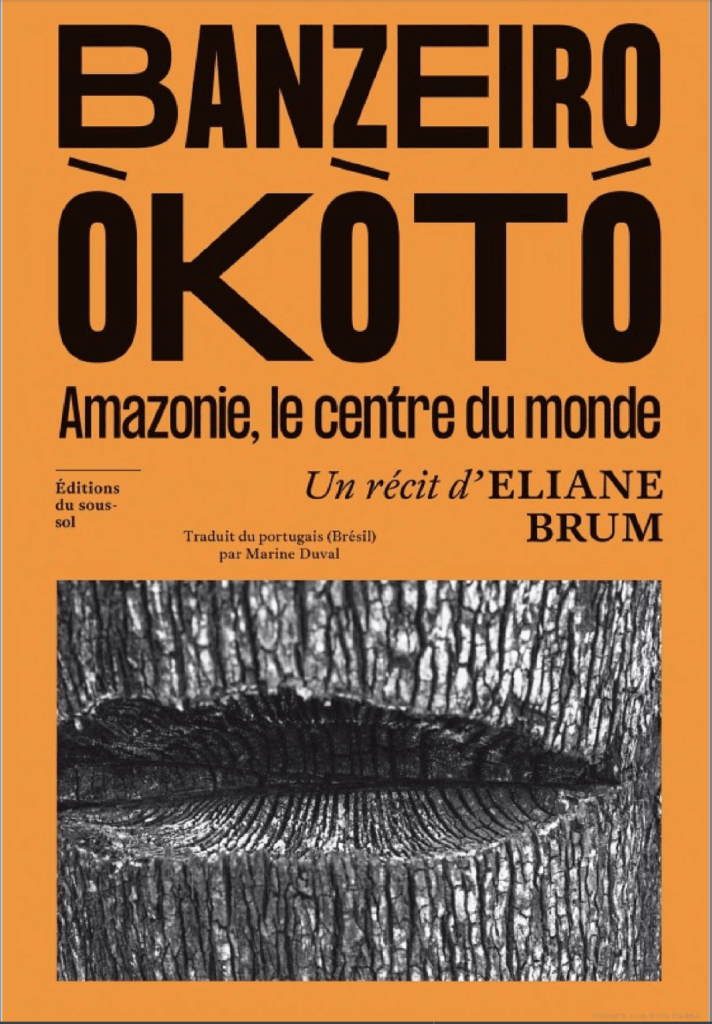
Et finalement, selon E. Brum, « l’effondrement du climat est le résultat d’une façon de comprendre le monde, principalement déterminée par la pensée occidentale, blanche, masculine et binaire ».
Par ailleurs, loin de revendiquer l’incarnation de la vertu, Eliane Brum développe le concept de « l’impossible innocence ». Selon ceconcept, la plupart des occidentaux, quelques soient leurs valeurs individuelles, ne peuvent se détacher du fait que leur confort de vie relatif est quelque part le résultat d’un passé fait d’invasions, de colonisations, de l’esclavage et de l’extraction de richesses naturelles. Non pas que nous en soyons individuellement responsables, mais que nous le voulions ou non, nous « profitons » des injustices du passé.
« L’impossible innocence » se traduit également par le fait que même avec la meilleure volonté du monde en tant que consommateur, nous avons du mal à ne pas nourrir un système que nous critiquons par ailleurs : nous utilisons la voiture avec du carburant dont les fournisseurs ne sont pas précisément universellement éthiques.
Les voitures électriques fonctionnent avec des batteries réalisées avec des composants extraits par des êtres humains dans des conditions que nous ignorons mais qui probablement relèvent souvent de l’exploitation. Si nous voulons manger bio ou végan, sommes-nous sûrs des circuits de distributions, des valeurs du supermarché du coin où nous allons acheter ces produits ? Cette « impossible innocence » ne doit cependant pas être considérée comme désespérante ou paralysante. Au contraire, elle permet d’intégrer factuellement, au lieu de les nier, des paradoxes qui font partie de notre histoire collective.
En parallèle, Eliane Brum développe l’idée de la planète en tant qu’unité de réflexion. L’autrice suggère que la distinction consciente ou non des « humains » versus les « êtres vivants non humains »(plantes et animaux) et la « nature » en général ne permet pas de saisir l’interrelation entre les composantes qui font l’unicité de la planète Terre. En ce sens, elle parle non pas des peuples de la forêt amazonienne mais des « peuples-forêts » qui constituent une unité d’interaction. Car détruire ces peuples détruit la forêt et détruire la forêt détruit les peuples. Elle conclut de façon convaincante qu’il y a rarement génocide sans écocide ou écocide sans génocide.
Le futur, l’espoir et le bonheur : L’autrice soutient que l’injonction à l’Espoir a remplacé la promesse du Bonheur en tant qu’argument politique. En effet, de nos jours, il est compliqué de promettre du Bonheur aux populations (en particulier aux jeunes): les crises (géo-) politiques, sociales, environnementales, climatiques rendent la promesse de bonheur relativement décalée. En revanche, l’Espoir et l’Optimisme sont les éléments quasi-imposés du discours politique. Eliane Brum suggère que, si chacun est libre d’avoir de l’espoir et de l’optimisme, il ne faut pas s’interdire de faire un constat réaliste et sans concession d’une situation globale extrêmement préoccupante. A ce sujet, elle décrit par exemple la stratégie d’extrême droite consistant à donner l’Espoir de retrouver un passé glorieux fantasmé (MAGA), tout en niant les effets du changement climatique par exemple. Si Espoir il y a, il se retrouve plus dans la prise de conscience et de parole de la jeunesse, symbolisée entre autres par Greta Thunberg.
Pour conclure, je trouve que ce livre illustre parfaitement la différence entre radicalité et extrémisme. Là où l’extrémisme renvoie à l’intolérance et à une pensée fermée, la radicalité permet au contraire d’aller à la racine des problèmes, d’explorer sans concession leurs causes profondes, comme le propose Eliane Brum dans ce livre.
Christophe M. Les Insoumis du Pic Saint Loup (34)
